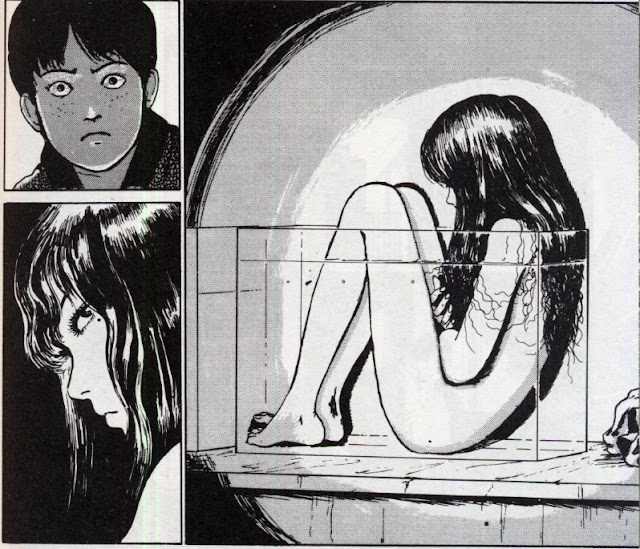Le moteur principal des mangas de Junji
Ito est l’obsession : les spirales (Spirale),
les animaux marins (Gyo) ou les chats
(Le Journal des chats). Ils nous font
comprendre ce qu’est avoir un esprit obsessionnel. Ça ne vous est jamais arrivé
de marcher dans la rue et de vous dire : « C’est étrange, toutes les
femmes que je croise aujourd’hui sont blondes »? Ou encore : « Depuis
30mn que je suis à cette terrasse de café, c’est incroyable le nombre de bossus que je vois passer » ? (Cette réflexion est véridique). Ou encore : « ce train est remplie
de sosies de Jean-Pierre Chevènement » ? (véridique aussi).
C’est cela les
récits de Junji Ito : si on commence à voir des spirales on ne voit plus
que ça, on les recherche même et on finit par avoir le cerveau en spirale. Et au
Japon, des spirales, il y en a partout, jusque dans la soupe.
Le cycle Tomie (20 récits entre 1987 et 2000) est aussi un récit d’obsession.
Soit les aventures d’une adolescente à la beauté surnaturelle qui parasite des écoles,
des familles, des groupes d’amis, provoque la passion suivie de crises de folies
meurtrières.
Tomie finit invariablement démembrée par ses amoureux ou rivales mais
renait à chaque nouvel épisode. On pense d’abord que Tomie est un fantôme,
peut-être une jeune fille assassinée comme Sadako ou les membres de la famille
Saeki dans Ju-on, et qu’elle accomplit
une vengeance systématique, pour ne pas dire mathématique. Pourtant, Tomie ne s’inscrit
pas dans la logique des fantômes japonais qui, aussi effrayant soient-ils demeurent
immatériels et n’ont pas de contacts physiques avec les humains. A ce titre,
elle ressemblerait d’avantages aux fantômes coréens des années 2000 comme ceux
de la série Whispering Corridors (Yeogogoedam, 1998-2009) : sanguins, violents,
souvent dissimulés sous une apparence humaine et n’hésitant pas à tuer, le plus
souvent à l’arme blanche. Tomie se rapproche aussi de la body-horror comme si à partir d’un seul membre coupé
de Tomie, une Tomie entière était capable d’être produite. Dans l’histoire La Chevelure (1995) un cheveu qui se
greffe sur le crâne d’une jeune fille la transforme peu à peu en Tomie. Est-elle
animale, comme une sorte de salamandre, ou bien végétale, pouvant se reformer
par boutures ? Et lorsque les reproductions se dérèglent Junji Ito dessine des grappes anarchiques de Tomies.
Dans l’épisode L’agresseur
(2000), du sang de Tomie a été injecté à des nourrissons qui toutes sont
devenues des Tomie du même âge, ont grandi dans des milieux différents, et
cherchent à s’éliminer. La guerre des Tomies donc.
Comme beaucoup de dessinateurs
japonais, Junji Ito dessine un seul type de personnage, qu’il soit fille ou un
garçon. On retrouve dans ses autres récits des filles ressemblant trait pour
trait à Tomie. A un détail près : un grain de beauté sous l’œil gauche est le signe distinctif de la créature. Tomie est donc surtout une
métaphore de l’identité qui a un certain point de ressemblance finit par s’entredévorer
ou prendre des formes cancéreuses. La perte de l’individualité est évidemment
la terreur japonaise par excellence, et si Tomie est une adolescente habillée
en uniforme marin, ce n’est pas un
hasard. Tomie pourrait ainsi être une adolescente originelle, éternelle shojo, c’est-à-dire vierge et sans
cesse prise dans un mouvement de renaissance. Mais évidemment une ankoku shojo, vierge des ténèbres, monstrueuse et cannibale. Figure autant
consommatrice que consommée, elle dévore les garçons par la passion qu’elle
inspire et les filles par la jalousie et l’obsession de la beauté. Quant aux
adultes, qui constituent son entourage, ils sont amaigris, les yeux caves,
et la peau creusée, comme des drogués affamés de Tomie et jamais rassasiés.
Tomie a donné lieu tout d’abord à huit films entre 1999 et 2007, dont un réalisé par Takashi Shimizu l’auteur des Ju-on, Tomie: Re-birth (2001). Aucun n’est remarquable, et les actrices interprètes
de Tomie très décevantes. Tomie a connu sa meilleure renaissance en 2012 avec
Tomie Unlimited de Noboru Iguchi. La folie organique qui est le propre d’Iguchi s’accorde parfaitement à l’univers d’Ito.
La seconde série adapte certaines cases du manga (L'hôpital Morita par exemple), le
travail photographique parvenant à restituer la terrorisante beauté de Tomie.
La série sur le site de Yoshida Shun ici et ici (attention le site a une bande-son de pure J-horror)
Les histoires de Tomie sont éditées
en France par Tonkam ici
Tomie Unlimited est édité en DVD/BR
par Elephant Films