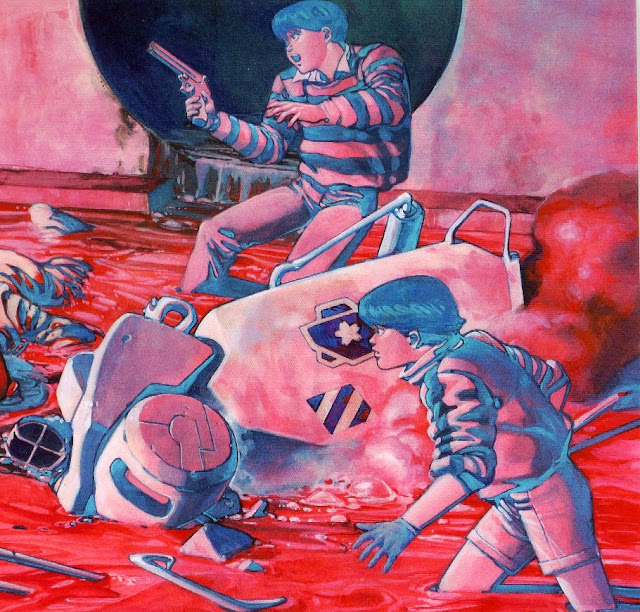En septembre 2009, après bien des recherches, les documents français étant rares, je publiais sur mon blog (Les Films libèrent la tête) un portrait d'Akihiro Miwa, flamboyante et énigmatique créature du cinéma japonais. J'y suis revenu plusieurs fois par la suite, surtout au gré de découvertes iconographiques. Voici l'intégralité des billets consacrés à Miwa.

Chanteur adulé, comédien pour le théâtre et le cinéma, vedette de la télévision à l'instar d'un Takeshi Kitano (1), Akihiro Miwa est une figure non seulement transgenre mais surtout transdisciplinaire, à la fois populaire et underground, qui pourrait résumer 50 ans de la vie culturelle japonaise.
Né en 1935, Miwa est à 17 ans l'une des vedettes des bars gays de Ginza et en particulier le Brunswick où il rencontre Yukio Mishima (2). Mishima et celui qui est alors plus communément appelé Maruyama se lient d'amitié. Celle-ci fut très fructueuse. Mishima est apparu dans certains spectacles de cabaret de Miwa, pour lesquels il composait des chansons. Miwa fut la vedette de deux adaptations cinématographiques de pièces de Mishima : le célèbre Lézard Noir (Kurotokage, 1968) et le moins connu Manoir de la rose noire (Mansion ot the Black Rose/ Kuro bara no yakata, 1969), tous deux réalisés par Kinji Fukasaku. Ce sont ces films qui popularisèrent la figure de Miwa en occident.

Chanteur adulé, comédien pour le théâtre et le cinéma, vedette de la télévision à l'instar d'un Takeshi Kitano (1), Akihiro Miwa est une figure non seulement transgenre mais surtout transdisciplinaire, à la fois populaire et underground, qui pourrait résumer 50 ans de la vie culturelle japonaise.
Né en 1935, Miwa est à 17 ans l'une des vedettes des bars gays de Ginza et en particulier le Brunswick où il rencontre Yukio Mishima (2). Mishima et celui qui est alors plus communément appelé Maruyama se lient d'amitié. Celle-ci fut très fructueuse. Mishima est apparu dans certains spectacles de cabaret de Miwa, pour lesquels il composait des chansons. Miwa fut la vedette de deux adaptations cinématographiques de pièces de Mishima : le célèbre Lézard Noir (Kurotokage, 1968) et le moins connu Manoir de la rose noire (Mansion ot the Black Rose/ Kuro bara no yakata, 1969), tous deux réalisés par Kinji Fukasaku. Ce sont ces films qui popularisèrent la figure de Miwa en occident.
C'est à un ami de Mishima, le célèbre Yasuzo Masumura (L’Ange rouge, La Bête aveugle) que Miwa doit sa première apparition à l'écran. Dans Courants chauds (Danryu, 1957), il interprète un chanteur mais son apparence, bien que très efféminée, est encore celle d'un garçon. Par la suite, jamais Miwa n'apparaîtra sous une autre apparence que féminine, ce qui est encore le cas aujourd'hui. C'est donc plus commodément au féminin que nous parlerons de l'artiste.

Plus qu'un travesti, Miwa modernise la figure de l'onnagata (forme de femme), acteur de théâtre kabuki spécialisé dans les rôles féminins. L'onnagata naît en 1629 d'un décret du shogun interdisant la scène aux femmes. Censée combattre la prostitution des actrices, cette loi permis l'éclosion de ces figures androgynes, creusets de troubles et de fantasmes. Alors que le travesti occidental est souvent cantonné dans le burlesque, l'onnagata japonais est respecté et même vénéré (voir La vengeance d'un acteur de Kon Ichikawa). Même s'il n'est pas forcément homosexuel, l'onnagata conserve idéalement en dehors des planches une apparence féminine. Mishima a consacré à cette figure l'une de ses plus belles nouvelles, intitulée justement Onnagata, et inspiré par l'acteur Utaemon Nakamura dont il était proche.
« Mangiku n'exprimait jamais rien - même la force, l'autorité, l'endurance, le courage - autrement que par le seul moyen dont il disposait : une expression féminine. » (3)


(Miwa à ses débuts, encore sous l’apparence d’un garçon)
Plus qu'un travesti, Miwa modernise la figure de l'onnagata (forme de femme), acteur de théâtre kabuki spécialisé dans les rôles féminins. L'onnagata naît en 1629 d'un décret du shogun interdisant la scène aux femmes. Censée combattre la prostitution des actrices, cette loi permis l'éclosion de ces figures androgynes, creusets de troubles et de fantasmes. Alors que le travesti occidental est souvent cantonné dans le burlesque, l'onnagata japonais est respecté et même vénéré (voir La vengeance d'un acteur de Kon Ichikawa). Même s'il n'est pas forcément homosexuel, l'onnagata conserve idéalement en dehors des planches une apparence féminine. Mishima a consacré à cette figure l'une de ses plus belles nouvelles, intitulée justement Onnagata, et inspiré par l'acteur Utaemon Nakamura dont il était proche.
« Mangiku n'exprimait jamais rien - même la force, l'autorité, l'endurance, le courage - autrement que par le seul moyen dont il disposait : une expression féminine. » (3)

(Miwa en onnagata classique)
Jamais Miwa n'a cherché à camoufler certains traits masculins, un visage racé mais plutôt anguleux et surtout une voix aux inflexions graves. Si aucun des personnages qu'elle a interprétés n'est désigné explicitement comme un travesti, le travestissement est toujours présent en hors-champ. Miwa propose une version théâtrale, fétichisée à l'extrême, de la femme fatale, entre Marlène Dietrich et Joan Crawford. Le kitsch typiquement japonais dont relève Miwa est celui du théâtre Takarazuka, dont tous les rôles sont interprétés par des femmes ressemblant à des travestis masculins, mais aussi de personnages de manga tel Lady Oscar. Lorsque Miwa se bat à l’épée, c’est davantage par souci esthétique que par nécessité scénaristique.

(Le théâtre Takarazuka)
La plus célèbre incarnation de Miwa est le Lézard Noir, personnage de criminelle diabolique inventée par Edogawa Rampo (5). Comme Fantômas et Musidora, dont elle serait la version extrême-orientale, le Lézard noir est une experte en déguisements qui prend d'ailleurs parfois l'apparence d'un homme. Le choix de Miwa est donc un rire sous cape : le Lézard Noir serait intrinsèquement un leurre. On pourrait croire que Mishima adapte le roman de Rampo en se souvenant de la note de Susan Sontag (6) invitant à reconsidérer, sous l'angle du "camp", les meilleurs films de Feuillade.

Le Lézard Noir exprime l'attachement de Mishima pour la littérature populaire pourvoyeuse de frissons et de cruautés. Dans Confession d'un masque (titre qui pourrait admirablement s'appliquer à Miwa), Mishima évoque ses premières masturbations devant une reproduction du Saint Sébastien de Guido Reni. Le livre de Rampo s'ouvre sur une autre référence biblique et décadente, également au panthéon de Mishima : la danse de Salomé. Le Lézard Noir apparaît le soir du nouvel an dans un club privé, et commence à se dévêtir pour les convives.
« L’Ange noir allait, d’un moment à l’autre, devenir l’ange blanc : son corps complètement nu, ne serait plus couvert que de deux colliers de grosses perles, de magnifiques boucles d’oreilles en jade, de bracelets incrustés d’une multitude de diamants à chaque bras et de trois bagues à ses doigts. » (7)
Si Miwa ne reproduit pas la performance, elle danse néanmoins devant de grandes reproductions des dessins d'Aubrey Beardsley pour la pièce d’Oscar Wilde.

Dans le night-club psychédélique, repaire du Lézard Noir, les néons fluorescents, les corps bariolés, en transe, et les dessins cruels de Beardsley forment l'écrin où Miwa vient s'inscrire. Fukasaku expérimente les ruptures chromatiques et les zooms dynamiques qui seront la marque de ses grands yakuza-eiga. Ce monde au bord du chaos se fige soudain à l'apparition du Lézard Noir, équivoque créature qui aurait pu naître dans l'imagination surchauffée de Huysmans et Jean Lorrain. Outre son activité de voleuse de diamants, le lézard noir est une artiste décadente qui transforme ses victimes en statues de chair et les expose dans son musée des horreurs (8). Le Lézard Noir est une variation sixties de Des Esseintes, donc une militante Camp.

« Le Camp écrit Sontag, est un certain modèle d'esthétisme. C'est une façon de voir le monde comme un phénomène esthétique. Dans ce sens — celui du Camp — l'idéal ne sera pas la beauté; mais un certain degré d'artifice, de stylisation. »
Seul un travesti, maître des simulacres, peut régner sur ce monde de signes, souvent réduit à une pure surface (Le Lézard noir est une fantaisie Pop Art contemporaine du Danger Diabolik de Mario Bava).
L'ironie ne pourrait cependant définir totalement la figure de Miwa, forgée par le sentimentalisme excessif de la Enka, chanson romantique japonaise dont elle s'est faite l'une des plus grandes interprètes. Si le détective Akechi récupère le dament dérobé à l'industriel, celui-ci est sans valeur comparé à la véritable pierre précieuse qu'il conquiert : l'amour du Lézard Noir.
"Et moi, je compris vite que ton cœur à toi était une vraie pierre précieuse, un pur diamant" lui déclare-t-il alors qu'elle meure dans ses bras (9).

Suite immédiate du Lézard Noir, Le Manoir de la rose noir abandonne le serial pour le mélodrame gothique.
L’introduction du personnage dans la fiction est presque identique dans les deux films : Miwa incarne Ryuko, une femme mystérieuse, apparaissant chaque soir à minuit dans un club privé.

Une rose noire à la main, elle méduse son assistance, exclusivement masculine, en interprétant une chanson exotique. Une légende entoure Ryuko : sa rose deviendrait rouge lorsqu'elle aura trouvé l'amour véritable. Parfois des hommes, ravagés par la passion, affirment l'avoir connue par le passé... prétendants pantelants qu'elle rejette d'un éclat de rire.
Miwa projette l'image d'une femme idéale, chimérique. Lorsque sonne minuit, passe un fantôme d'amour que les hommes ne peuvent saisir. Ryuko elle-même ne pourra que mourir lorsqu'elle tentera de s'incarner pour vivre la passion véritable... tel est le sens de cette rose qui vire au rouge de la passion et du sang.



Miwa se met en scène comme un songe, une splendide composition esthétique, une pure image de spectacle. Le sous-texte transsexuel est ici davantage désenchanté que dans Le Lézard Noir.
« Le faire-semblant de sa vie quotidienne, écrit Mishima, était le support du faire-semblant de ses représentations sur scène. Voilà, Masuyama en était convaincu, ce qui faisait le véritable onnagata. L'onnagata naît de l'union du rêve et de la réalité. »
Miwa ne peut être qu'une figure mélancolique, condamnée à mimer parfaitement l'amour des hommes et des femmes sans jamais y participer.
Ces deux productions resteront malheureusement les seules à mettre Miwa en vedette, symbole de la liberté dont a pu jouir le cinéma japonais dans les années 60 et 70.
Avant de quitter les écrans, Miwa fit pourtant une ultime apparition dans Jetons les livres, descendons la rue (1971) de Shuji Terayama. Miwa reprend le rôle qu'elle tenait dans la pièce La Marie Vison, spécialement écrit pour elle par Terayama.

Quasiment nue dans une baignoire, elle interprète la reine d'un enfer aux teintes roses dont "même le propriétaire serait gay"... Dans cet enfer déserté, au milieu de poupées en plastiques, la reine attend désespérément qu'un damné se présente pour tromper son ennui. Miwa prend naturellement place dans l'univers "fardé" de Terayama, parmi les "créatures flamboyantes" de ce frère japonais de Jack Smith.


Comme si son personnage était parvenu au bout de ses représentations cinématographiques, Miwa se consacra à la scène et à la chanson. Son très beau répertoire, qui s'étend de la Enka à des airs populaires japonais, fait également la part belle à des adaptations mélodramatiques de chansons de Piaf, Aznavour ou Serge Reggiani. Pas plus que dans ses rôles, Miwa ne recherche la stricte imitation d'un timbre féminin (10). La voix masculine de Miwa, grave et profonde, donne sa pleine puissance lorsque le féminin s’empare d'elle et la pousse vers les octaves. Pour Miwa, le féminin équivaut à une force, jamais à une faiblesse ou une préciosité.
Au delà de la question des genres, au-delà de l'homme et de la femme, Miwa est avant tout un dandy, qui comme Brummell pourrait dire : "la création de moi-même est ma folie".


(1) Miwa apparaît d’ailleurs dans Takeshi’s dans son propre rôle de concurrente de Kitano à la télévision.
(2) Voir Henry Scott-Stokes, Mort et Vie de Mishima (1974), ed. Philippe Picquier 1996.
(3) Yukio Mishima, Onnagata (La mort en été,) Folio 1988.
(4) Voir Agnès Giard, L’imaginaire érotique au Japon, Albin Michel 2006.
(5) Une première version, réalisée en 1962 par Umetsugu Inoue, est interprétée par Machiko Kyô, l'actrice de Mizoguchi.
(6) Susan Sontag, Notes sur le camp (1964)
(7) Edogawa Rampo, Le Lézard Noir (1929), ed. Philippe Picquier 2002.
(8) Mishima est intégré au musée de chair du Lézard Noir, sous l’apparence d’une gouape à la Genet, maniant le cran d’arrêt.
(9) Yukio Mishima, Le Lézard Noir (1961), NRF 2000.
(10) Miwa a prêté sa voix à plusieurs dessins animés, le plus célèbres étant Princesse Monoke de Miyazaki où elle interprète le loup.
envoyé par sadakobanana - Regardez plus de clips, en HD !
Miwa en Lézard noir
album photo datant de 1968
Sa vie en images
En privé
Le retour du Lézard Noir
En 1994, Miwa donnait une série de représentation de son rôle le plus célèbre : la voleuse de diamants du Lézard Noir d'Edogawa Rampo dans l'adaptation théâtrale de Yukio Mishima. Plus de 25 ans après le film de Fukasaku adapté de la pièce qui l'a rendu populaire de part le monde, Miwa réendosse les tenues noires et lamées de l'aventurière.
Miwa Dietrich
A la recherche du Lézard noir
Je ne savais pas alors qu'un futur complice travaillait à un documentaire consacré à Miwa. C'est en 2013 que Miwa : A la recherche du Lézard noir de Pascal-Alex Vincent fut édité en DVD en France, et connut plus tard une sortie en salles au Japon. A cette occasion, j'avais fait pour le magazine Chronic'art une courte interview.
« Dans les années 90, je travaillais pour
une société spécialisée dans la distribution du cinéma japonais classique qui
avait en catalogue Le Lézard Noir
(1968). Le film était extrêmement intrigant. L'actrice qui jouait la méchante
portait un prénom masculin, alors que jamais le film ne la désigne comme un
travesti. Enfin ce film baroque et très féminin était réalisé par... Kinji
Fukasaku, dont j'avais vu plusieurs films de yakuzas plutôt...
"couillus", et masculins. Dans
La demeure de la rose noire, toujours
de Fukasaku, sa simple apparition faisait littéralement sangloter des yakuzas transis
d'amour, comme si Miwa avait distillé un poison féminin dans l'univers viril de
ce cinéaste. Je ne vois pas d'équivalent dans l'histoire de l'entertainement mondial : un acteur à qui
un gros studio confie le rôle féminin principal de 2 films de premier plan,
sans jamais communiquer sur le fait qu’il soit un travesti. Et un acteur, qui
plus est, en activité depuis... 1957, qui continue à se produire en récital, à
la télévision à l’image d’un Kitano, et tourne des publicités pour les
téléphones ou les chips. »
Pour commander le DVD sur le site des éditions Outplay ici